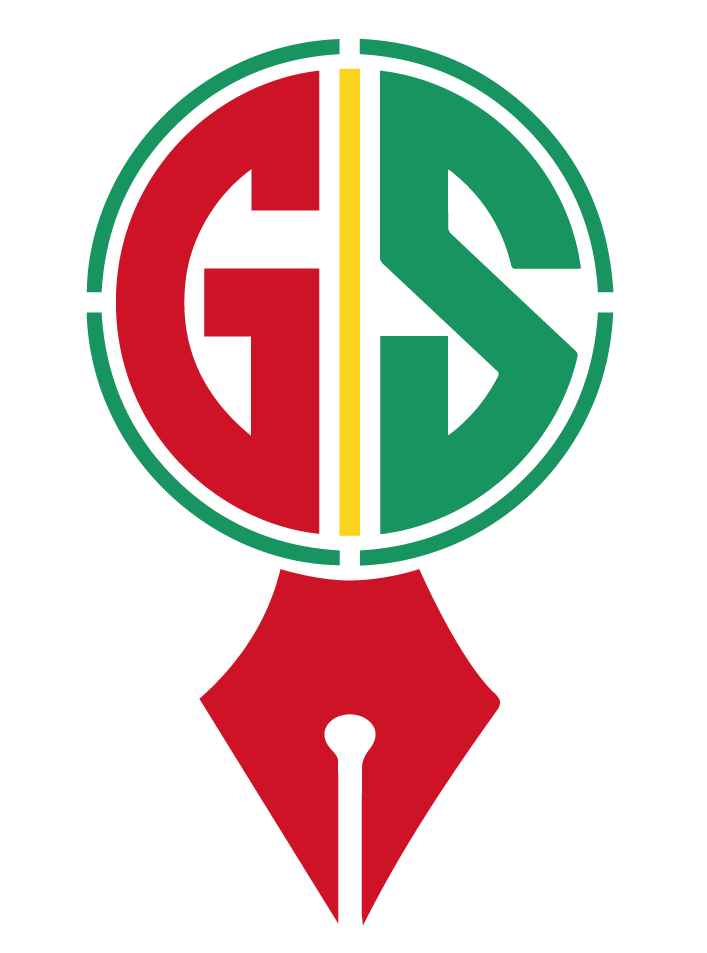Les viols sont “parfois collectifs ou même publics, devant un époux, devant les enfants : ces histoires laissent des traces insurmontables”, raconte la journaliste burkinabè Mariam Ouedraogo, qui n’en a jamais fini de raconter les violences des djihadistes qui frappent son pays depuis 2015.
Son regard vacille entre inquiétude et accablement, contrastant avec l’énergie de ses boucles rebelles et l’éclat de sa combinaison jaune. Cette femme de 42 ans, la première femme africaine à avoir remporté l’an dernier le prix Bayeux des correspondants de guerre, va au front toutes les nuits et chaque jour. Inlassablement.
“C’est ma croix”, dit avec simplicité la reporter du quotidien d’État Sidwaya, invitée récemment à une conférence sur le journalisme d’investigation à Johannesburg.
Le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes djihadistes affiliés à l’État islamique et à Al-Qaïda qui frappaient déjà le Mali et le Niger voisins. Elles ont fait plus de 17 000 morts et entraîné le déplacement de plus de deux millions de personnes à l’intérieur du pays.
Dans un rapport publié en mai 2022, l’ONG Human Rights Watch a indiqué avoir documenté plusieurs dizaines de cas de viols de femmes et jeunes filles par des groupes islamistes armés depuis septembre 2021 au Burkina, la plupart dans la région Centre-Nord.
Depuis quatre ans déjà, Mariam Ouedraogo écrit sur “les violences sexuelles liées au terrorisme, principalement le viol”, difficile à aborder “parce que chez nous au Burkina, tout ce qui touche à la sexualité, c’est tabou”. Le viol encore davantage.
Les victimes aussi n’aiment pas se confier “car ça touche à leur intimité et leur dignité”.
Mariam, mère d’une petite fille de sept ans, a tissé des liens forts avec ces femmes qui lui ont fait confiance. Au-delà du récit des violences, elle garde le contact pour les écouter et raconter la suite, la répudiation par leurs familles, les grossesses issues de ces violences, la naissance de ces enfants du traumatisme.
Recueillant ces “atrocités”, Mariam s’est sentie bouleversée au point de ne pas parvenir à garder un recul nécessaire, salutaire. Elle se débat depuis longtemps maintenant avec des symptômes de stress post-traumatique, insomnie, anxiété, dépression.
“Chaque fois qu’elles me racontaient leurs viols, c’est comme si je me faisais violer à leur place”, dit-elle, le regard voilé d’émotion. “Je n’ai pas peut-être su mettre de la distance entre ce qu’on me raconte et moi qui suis là, juste pour récolter”.
Aujourd’hui, “chaque fois qu’elles sont en détresse, elles m’appellent. Malheureusement je me vois impuissante”, ce qui suscite “un conflit interne qui jusqu’à aujourd’hui me persécute”.
Mariam Ouedraogo s’intéressait déjà aux blessés de la vie, aux personnes vulnérables. L’héritage d’une grand-mère maternelle exceptionnelle, une “dame de cœur” qui nourrissait et accueillait tous les “cas sociaux” de son quartier.
“Notre cour c’était comme un refuge pour tous les gens en difficulté, marginaux, veuves et orphelins”, se souvient-elle. Si elle sortait et laissait une paire de chaussures, à son retour la grand-mère les avaient données. “Elle estimait que moi et mes sœurs en avions assez, qu’on n’en avait pas besoin”.
Quand les attaques djihadistes ont commencé, la journaliste, musulmane comme la majorité des Burkinabè, s’est d’abord intéressée aux femmes impliquées dans les groupes d’autodéfense. Puis elle s’est rendue compte que “dans les tueries, on ne tuait pas automatiquement les femmes. Je me suis demandée pourquoi”.
Elle part sur le terrain. “Et là j’ai compris : on les traumatise autrement. J’ai su qu’on les violait, on les enlevait, on les séquestrait”. Sa grand-mère rétablissait, à sa petite échelle, de la justice sociale. Mariam s’inscrit dans sa lignée grâce au journalisme.
“Je suis sensible à la souffrance humaine, regardante sur ces petites choses autour de moi qui pour les autres peuvent sembler banales. Je capte tout ce qui est douleur”, dit cette grande sensible. Elle ne s’arrêtera pas. “Le cap est franchi, je continue sur le sujet des viols. Ces femmes ont besoin de moi”.
Quitte à perdre à jamais le sommeil. “Toutes les nuits, je suis à un carrefour, entre armée et terroristes. J’oriente les gens, les populations : fuyez, ils arrivent, ils sont là. Tous les matins je me réveille épuisée”, confie-t-elle.
De la capitale Ouagadougou, où il y a déjà eu des attaques, elle se rend à une centaine de km pour rencontrer des femmes déplacées. “Le risque zéro n’existe pas. S’ils sont partout, nul n’est à l’abri”, dit-elle un brin fataliste. “On part la peur au ventre mais on y va quand même.”













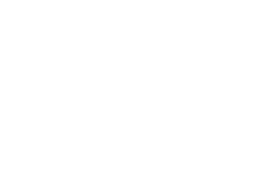 Abonnez-vous à notre chaine
Abonnez-vous à notre chaine